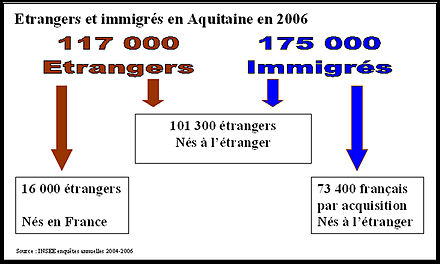Classement des quarante plus villes d'Aquitaine (population municipale en 2012)
Rang
|
Ville
|
Nombre
d’habitants
|
Département
|
1
|
Bordeaux
|
241 287
|
Gironde
|
2
|
Pau
|
78 506
|
Pyrénées-Atlantiques
|
3
|
Mérignac
|
66 660
|
Gironde
|
4
|
Pessac
|
59 223
|
Gironde
|
5
|
Bayonne
|
45 855
|
Pyrénées-Atlantiques
|
6
|
Talence
|
41 358
|
Gironde
|
7
|
Anglet
|
39 223
|
Pyrénées-Atlantiques
|
8
|
Agen
|
33 730
|
Lot-et-Garonne
|
9
|
Mont-de-Marsan
|
31 018
|
Landes
|
10
|
Périgueux
|
29 906
|
Dordogne
|
11
|
Villenave-d’Ornon
|
29 804
|
Gironde
|
12
|
Saint-Médard-en-Jalles
|
28 839
|
Gironde
|
13
|
Bergerac
|
27 972
|
Dordogne
|
14
|
Bègles
|
25 380
|
Gironde
|
15
|
Biarritz
|
25 330
|
Pyrénées-Atlantiques
|
16
|
La Teste-de-Buch
|
24 952
|
Gironde
|
17
|
Gradignan
|
23 930
|
Gironde
|
18
|
Libourne
|
23 736
|
Gironde
|
19
|
Villeneuve-sur-Lot
|
23 377
|
Lot-et-Garonne
|
20
|
Le Bouscat
|
23 376
|
Gironde
|
21
|
Cenon
|
22 385
|
Gironde
|
22
|
Eysines
|
21 063
|
Gironde
|
23
|
Lormont
|
20 740
|
Gironde
|
24
|
Dax
|
20 364
|
Landes
|
25
|
Gujan-Mestras
|
20 136
|
Gironde
|
26
|
Marmande
|
18 458
|
Lot-et-Garonne
|
27
|
Hendaye
|
16 759
|
Pyrénées-Atlantiques
|
28
|
Floirac
|
16 508
|
Gironde
|
29
|
Cestas
|
16 379
|
Gironde
|
30
|
Bruges
|
16 269
|
Gironde
|
31
|
Blanquefort
|
15 149
|
Gironde
|
32
|
Ambarès-et-Largrave
|
14 112
|
Gironde
|
33
|
Biscarosse
|
13 391
|
Landes
|
34
|
Billère
|
13 367
|
Pyrénées-Atlantiques
|
35
|
Saint-Paul-lès-Dax
|
13 139
|
Landes
|
36
|
Saint-Jean-de-Luz
|
12 994
|
Pyrénées-Atlantiques
|
37
|
Tarnos
|
12 423
|
Landes
|
38
|
Lons
|
12 068
|
Pyrénées-Atlantiques
|
39
|
Andernos-les-Bains
|
11 376
|
Gironde
|
40
|
Arcachon
|
11 307
|
Gironde
|